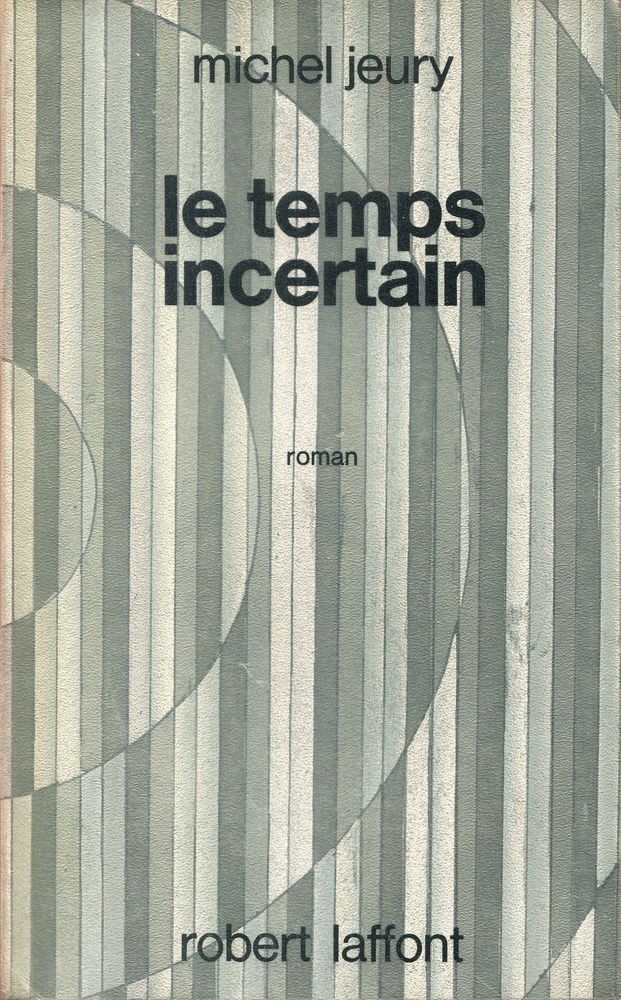
Que nous dit Dany ? Une chose apparemment toute simple et pourtant tellement singulière, voire sidérante : qu’il existe une correspondance flagrante et démontrable (ce qu’elle s’emploie à faire) entre ce chapitre, écrit voici plus de quarante ans par Michel, et les moments de sa fin, qu’elle-même a vécus auprès de lui.
Ce qui pourrait sembler d’un abord indiscret ou même impudique par son approche intime de ces moments douloureux, ce qui pourrait même s’avérer difficile à lire pour qui a été proche d’un auteur phare mais aussi d’un homme particulièrement gentil, difficile voire intolérable aux yeux de ceux qui pensent qu’on ne parle pas de la sorte de la mort d’un proche, est pourtant fascinant. Fascinant, car témoignage d’une réflexion rare, mais surtout incroyablement voisin d’une expérience de pensée qui viserait à mieux approcher le fonctionnement d’une pensée, celle de l’auteur du plus grand livre de science-fiction français, d’un immense livre tout simplement, perpétuellement à relire pour ce qu’il nous dit, que ce soit en 1973 lors de son arrivée fracassante ou en 2019, alors que Michel Jeury a peu à peu, hélas, déserté les rayonnages des librairies. Car relire les premières pages du Temps incertain demeure une expérience toujours renouvelée, à l’image de la structure du livre et de la vision du temps qu’il véhicule, qui est tout excepté linéaire, fragmenté comme les personnalités des protagonistes, comme l’identité de celui qui traverse le récit, Holzach, Diersant, Renato…
Le parallèle que Dany établit entre ces lignes percutantes
qui signèrent l’irruption en science-fiction française de celui qui allait
profondément la changer, et les derniers moments de celui-ci même qui est
surtout son père, ce rapprochement pourrait paraître vain, ou alors issu d’une
vision trop naïve des synchronicités et des collisions d’esprits, de moments,
de ressentis. Ce n’est bien entendu ni l’un ni l’autre. La vision que nous
transmet Dany est toute entière pénétrée d’une grande complicité unissant le
père et la fille, au point de créer aux yeux de celle-ci davantage qu’une
empathie : une télépathie qui ne dit pas son nom mais qui permet à deux
esprits de communier sinon de fusionner. Lire aujourd’hui ce témoignage dénué
de la moindre tentative de taire le réel, ce Michel emporté vers sa fin et qui
devient le contraire de celui qu’il était, découvrir les rapports à tout le
moins étranges que cette fin tisse avec le début de son plus grand livre, voilà
qui déstabilise au premier abord, alors qu’au travers des voix mêlées du
romancier, de l’homme aux derniers instants de son existence, et de sa fille qui
noue ces fils qui lui paraissent si évidents, nous lecteurs avons non pas
l’impression, mais bien la quasi certitude, d’assister à la révélation d’une
vérité tellement claire qu’elle en devient quasi incandescente. Car nous savons
qu’avec la proximité de Michel, même s’il n’est plus là au regard de nos sens,
sa fille ne peut rien inventer.
Pour moi, pour mon vieux fonds rationaliste toujours bien
présent face aux divers complotismes, face aux dilueurs d’eau claire, face aux
semi-gourous de la plantation bio qui sont de réels escrocs, tout cela aurait
pu être balayé : correspondances, synchronicité, télépathie – mais de quoi
parle-t-on ? (On devrait retrouver dans l’une ou l’autre des chroniques
que j’ai jadis consacrées aux livres de Michel, un avis sans doute trop tranché
quant aux dérives mystiques que je pensais y lire.) Pourtant, cette relation complice entre deux
êtres ne saurait être niée sans oublier l’évidence de deux esprits proches,
deux esprits que le lecteur, à l’esprit complice à son tour, le mien en
l’occurrence, sait avoir quelquefois approchés de près, si près qu’un doute
quant aux faits relatés (dirait le rationaliste) se mue en désir profond
d’accepter cette relation que nous offre Dany d’avoir touché au mieux la
compréhension de l’esprit de son papa, et d’avoir intégré la certitude que
Michel nous parle à travers le temps et la mort. Il suffit pour s’en convaincre
de regarder cette photo de la petite fille et de son papa, auprès de cette
inscription fictive, alors, bornant la vie de Michel aux années 1934 et 2015.
Si Dany a vu, et sans doute vécu, les derniers instants de Michel comme une
entrée en chronolyse, sur quelle base prétendre qu’on pourrait balayer cette
expérience ? Il existe dans l’écriture de Dany une sincérité qui ne peut
jamais, elle, se voir niée. Elle exprime ce qu’elle ressent et ce qu’elle
comprend, que l’autre, le lecteur, y croie ou non. Au travers de ce témoignage,
de ce récit sans fard, de cette interprétation des faits, des paroles, des
idées, elle finit par nous révéler la totalité de la pensée d’un Jeury qui
persiste à s’affirmer comme un très grand auteur, et surtout comme un être
humain particulièrement proche de ses semblables et soucieux de tout ce qu’il
peut, lui, leur apporter. Cela, je le sais, et sans m’attarder sur mes propres
rapports avec lui (qui ne pourraient que flatter tout juste mon propre ego), je
le sais pour l’avoir vécu. Pour ceux qui l’ont approché, Michel était un être
exceptionnel, entre tout ce qui nourrissait son oeuvre et tout ce qu’il
offrait.
Après lecture, je ne peux que dire un mot à Dany :
merci. Ce témoignage intime est tout excepté intolérable. Il parle de pensée,
de conscience, des rapports entre celles-ci et le réel phénoménologique. Il est
porteur d’espoir et d’amour. Parlera-t-il à chacun, ou uniquement à ceux qui
ont connu père et fille ? Je ne sais. Personnellement, il m’a profondément
touché – et fait verser une larme, parce que je revois Villedieu en 2015 et que
je me remémore tous ces moments avec Michel, de lectures, de complicité, de
partage. Et après cette lecture-ci, le vieux rationaliste se retourne sur son
parcours, comme la vache de l’hôpital Garichankar parvenue au bord du monde, et
soupire : moi qui appelle à démonter toute croyance et à préférer
l’approche sceptique, voilà soudain que j’aimerais tant croire en la réalité de
l’éternité subjective.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire